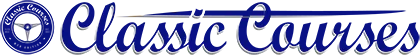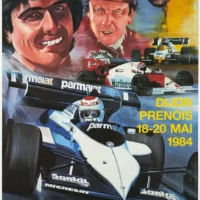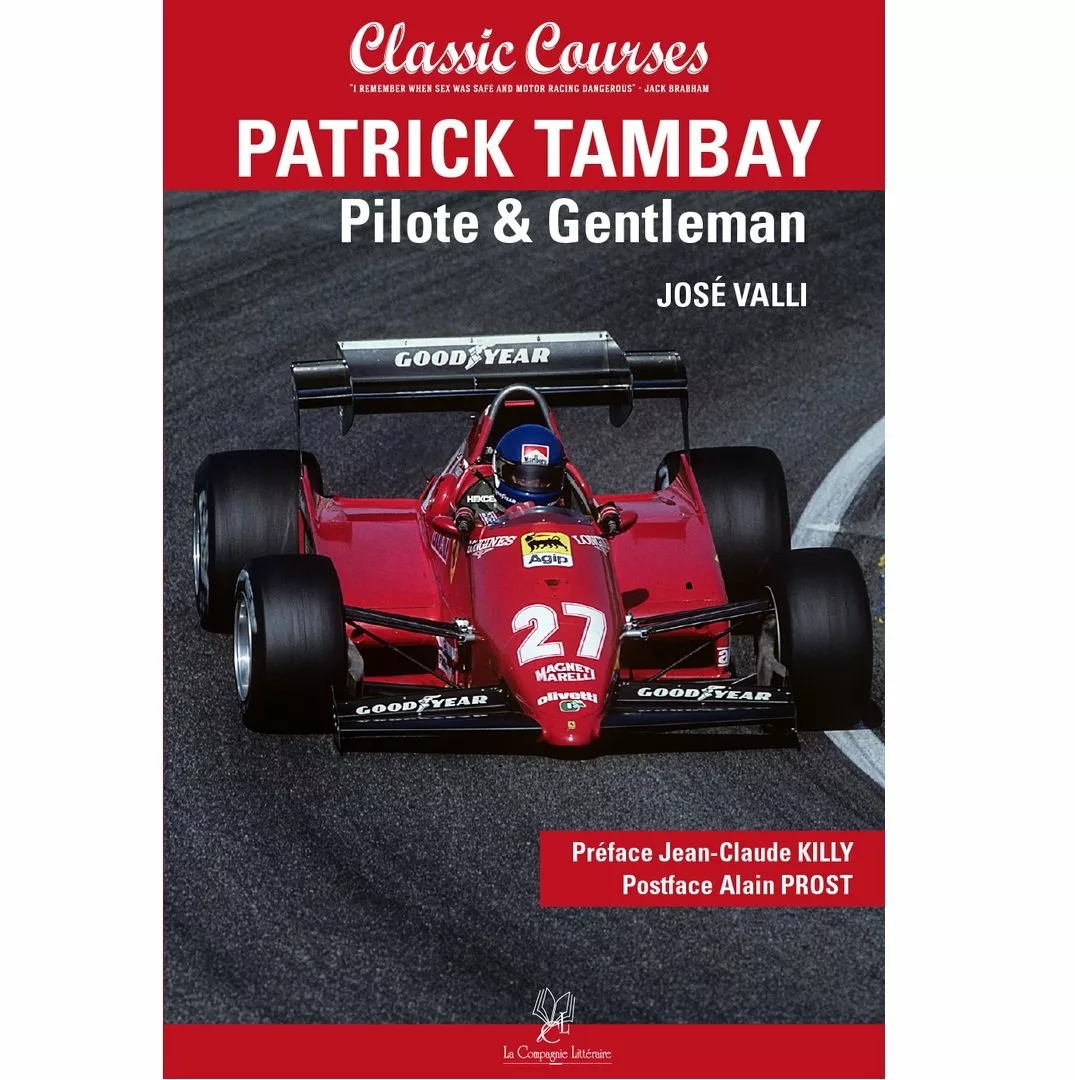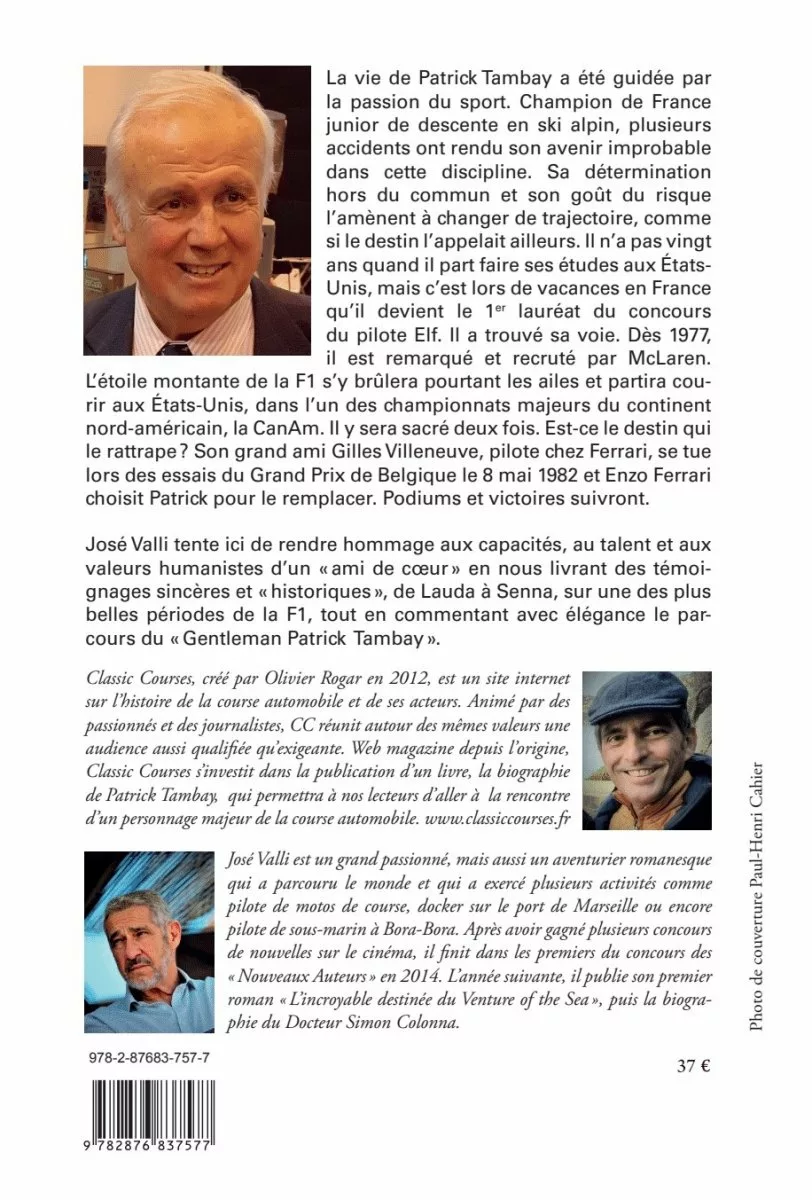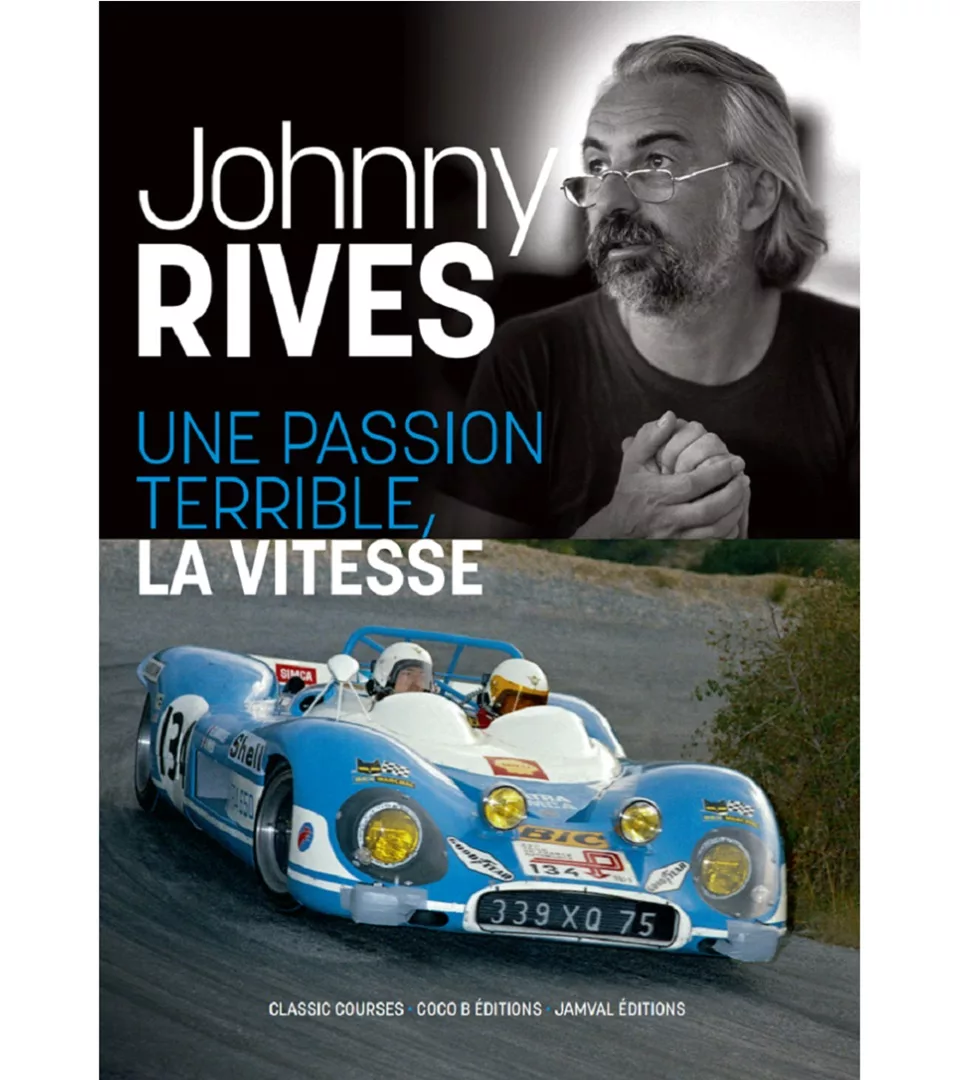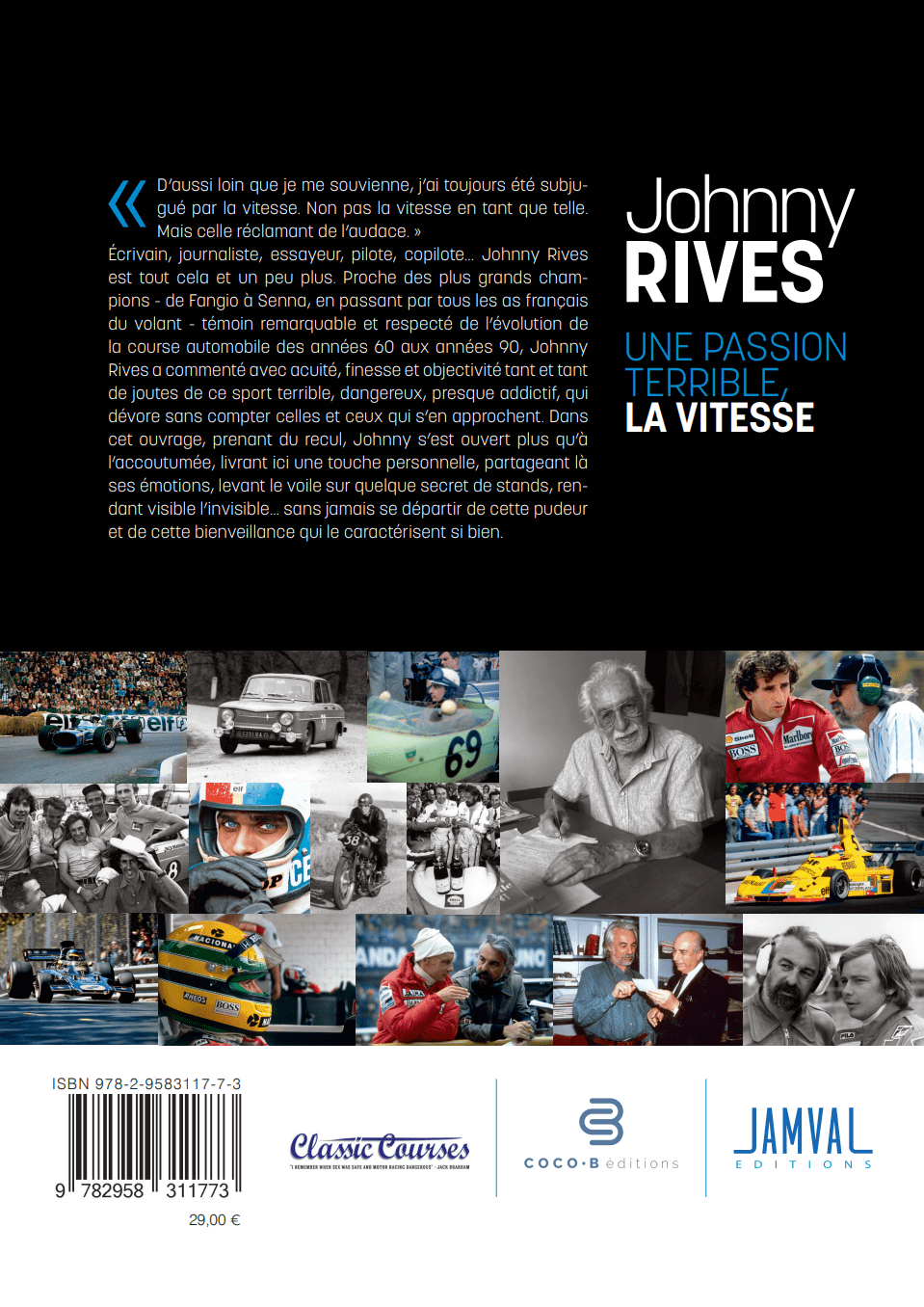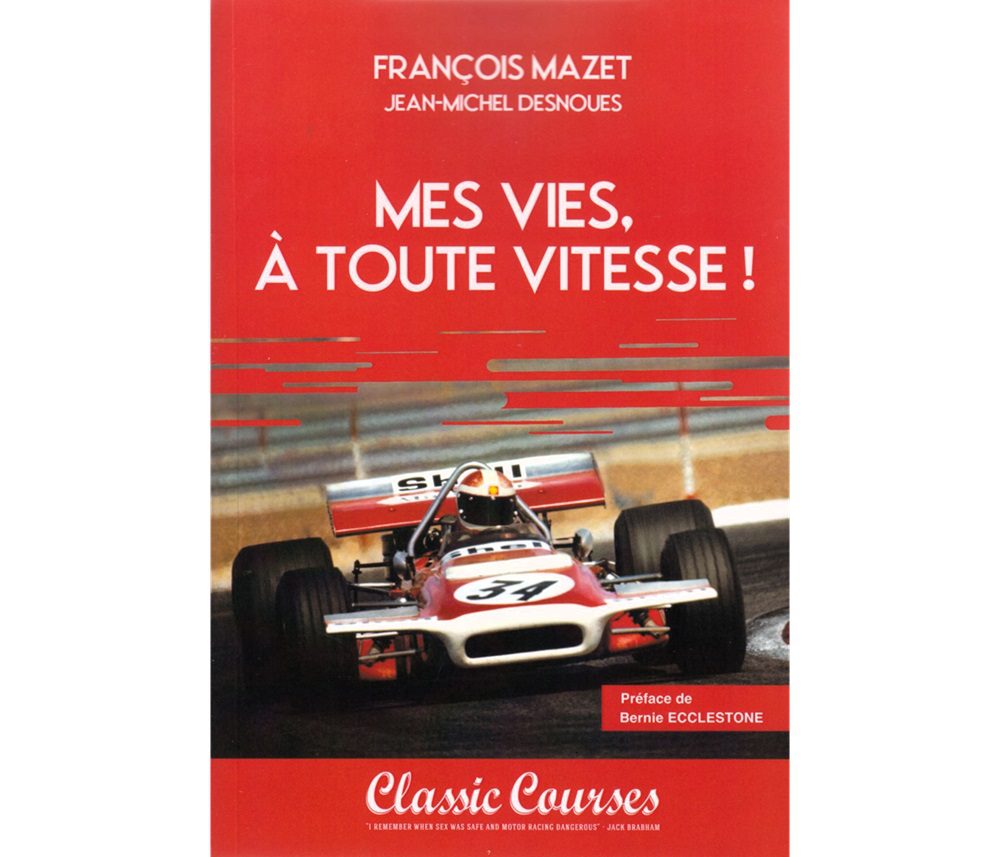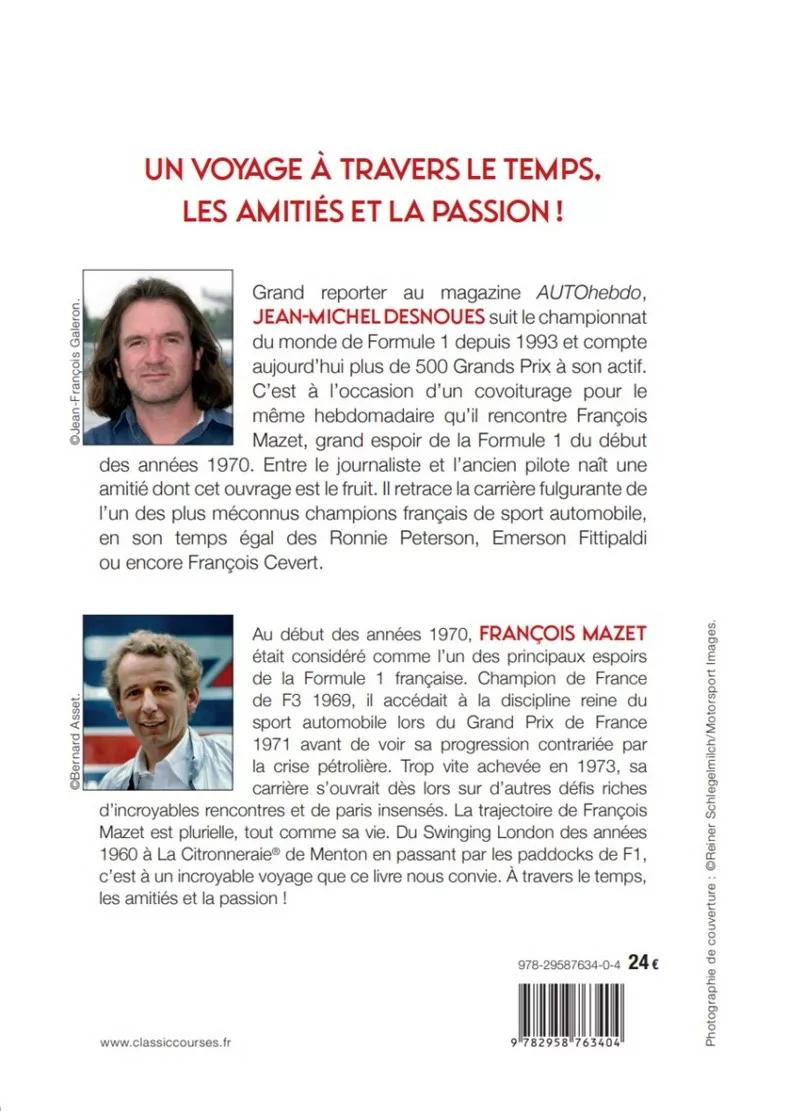Quelqu’un a un jour écrit que « la saison 1976 contenait tous les ingrédients d’un énorme film à suspense ». Le pas à franchir pour la porter à l’écran était énorme tant la reconstitution d’une époque disparue serait lourde à assumer techniquement parlant. Ron Howard l’a fait, et l’a réussi.
Soyons francs, et un brin lucides : le sport automobile – et le sport en général – n’a jamais été bien retranscrit sur grand écran dès lors que les scénaristes ne se sont attachés qu’à montrer de belles images dépourvues de tout lien sérieux de construction. Grand Prix ou Le Mans, pour ne prendre que les deux plus célèbres productions du genre, ont certes marqué les esprits par les mythes évoqués et les moyens techniques mis en œuvre à l’époque pour recréer ces scènes de course qui ont fait rêver des générations de passionnés. Mais d’un strict point de vue cinématographique, ces films étaient d’une indigence rare tant leurs scénarios bâclés tenaient sur un post-it à côté de la liste des courses sur le frigo (je passe à fond de 6 par charité chrétienne sur les pathétiques Driven ou autre Michel Vaillant). On pourra opposer que le sport auto fut servi par des films à scénarios tels Un homme et une femme, Virages ou Le cercle infernal. Vrai. Mais ces productions n’utilisaient la course qu’en tant que décor à une histoire extérieure destinée à un large public pas forcément fana de voitures pétaradantes. L’alchimie entre les deux n’avait en fait jamais réussi à prendre. Le film de Ron Howard parvient à la réaliser, à quelques bémols près.
Oscarisé à Hollywood en 2001 pour Un homme d’exception, Howard l’avoue sans fard : il n’est pas un connaisseur du monde de la Formule 1. Mais son scénariste britannique Peter Morgan (Frost/ Nixon, The Queen, The last king of Scotland) vécut une jeunesse bercée par les exploits de James Hunt, et la dramatique bataille contre Lauda en 1976 est restée fermement gravée dans sa mémoire, prête à ressurgir au moment opportun. Ce moment fut trouvé lors de la rencontre avec des producteurs immédiatement passionnés par ce projet excitant. Le budget fut bouclé dans la foulée, Ron Howard – avec qui Morgan avait déjà travaillé sur Frost/Nixon – fut engagé et l’écriture du scénario put démarrer.
Morgan rencontra alors Alastair Caldwell (ex-mécanicien en chef de l’écurie McLaren à l’époque de Hunt) et Niki Lauda qui devinrent ses conseillés techniques sur le projet. Comme souvent en pareil cas, les spécialistes ramenèrent régulièrement le scénariste – et le metteur en scène – à la réalité des faits. Ceux-ci intégrèrent les remarques mais poussèrent en avant la nécessité de faire quelques entorses à cette vérité pour obtenir un bon scénario. Le compromis idéal est en général difficile à dégager, mais on peut dire qu’il a été globalement trouvé pour Rush.
 A l’inverse des précités, Rush est un vrai film, avec un vrai scénario. Scénario qui s’appuie avant tout sur la rivalité entre deux hommes qu’a priori tout opposait : le flamboyant Hunt désirant croquer la vie par tous les bouts au pragmatique Lauda écartant de sa vie toute futilité potentiellement nuisible à son programme de carrière. Et quel meilleur théâtre pour cette histoire incroyable que cette saison 1976 où le suspense dura jusqu’au dernier tour du dernier Grand Prix au Japon ! Howard et Morgan ont respecté l’ambiance et une certaine chronologie des faits tout en s’autorisant quelques libertés évoquées plus haut pour un scénario plus accrocheur. Malgré leur rivalité, Niki et James s’estimaient dès leurs premiers affrontements ? On va les faire se détester au début pour mieux les faire se rapprocher ensuite. Niki rencontra Marlene Knaus lors d’une soirée en Autriche ? Transposons ça en Italie avec une scène – hilarante – de panne de voiture et une prise en stop par deux tifosi trop contents de faire conduire leur Lancia à l’idole de toute la Péninsule. Lauda quitte le circuit du Mont Fuji aussitôt son abandon entériné ? Pas terrible. Il va attendre le résultat final dans la tension croissante du stand Ferrari alors que le déluge redouble de vigueur (il avait baissé d’intensité dans la vraie course). Si on veut bien admettre ces quelques « retouches » nécessaires au bon fonctionnement du scénario, on aimera cette histoire de passion et de folie.
A l’inverse des précités, Rush est un vrai film, avec un vrai scénario. Scénario qui s’appuie avant tout sur la rivalité entre deux hommes qu’a priori tout opposait : le flamboyant Hunt désirant croquer la vie par tous les bouts au pragmatique Lauda écartant de sa vie toute futilité potentiellement nuisible à son programme de carrière. Et quel meilleur théâtre pour cette histoire incroyable que cette saison 1976 où le suspense dura jusqu’au dernier tour du dernier Grand Prix au Japon ! Howard et Morgan ont respecté l’ambiance et une certaine chronologie des faits tout en s’autorisant quelques libertés évoquées plus haut pour un scénario plus accrocheur. Malgré leur rivalité, Niki et James s’estimaient dès leurs premiers affrontements ? On va les faire se détester au début pour mieux les faire se rapprocher ensuite. Niki rencontra Marlene Knaus lors d’une soirée en Autriche ? Transposons ça en Italie avec une scène – hilarante – de panne de voiture et une prise en stop par deux tifosi trop contents de faire conduire leur Lancia à l’idole de toute la Péninsule. Lauda quitte le circuit du Mont Fuji aussitôt son abandon entériné ? Pas terrible. Il va attendre le résultat final dans la tension croissante du stand Ferrari alors que le déluge redouble de vigueur (il avait baissé d’intensité dans la vraie course). Si on veut bien admettre ces quelques « retouches » nécessaires au bon fonctionnement du scénario, on aimera cette histoire de passion et de folie.
 Et on adhèrera aux métamorphoses étonnantes de Chris Hemsworth en James Hunt charismatique et de Daniel Brühl en Niki Lauda méticuleux. Spécialisé dans certaines grosses productions (Thor et The avengers), le premier désirait travailler avec Ron Howard depuis longtemps et accepta immédiatement l’offre. Il se documenta ensuite sur la vie du héros anglais disparu en 1993, rencontra son fils, et ceux – et celles – qui l’avaient côtoyé. Le second vient d’un cinéma plus « cérébral ». Remarqué dans Joyeux Noël, Goodbye Lenin ou Inglorious bastards., il dispose d’un atout clé pour tenir le rôle de Lauda : de nationalité allemande, Brühl parle aussi bien sa langue natale que l’anglais, l’italien où même le français (Lauda parlait allemand avec sa femme, anglais avec ses confrères et italien avec les mécaniciens Ferrari) ! Son défi par rapport à son partenaire australien fut par contre tout autre : il avait la lourde tâche d’incarner à l’écran un homme toujours vivant et mondialement connu. D’abord un peu sceptique, Niki l’invita à venir à Vienne et fut finalement ravi de la rencontre :
Et on adhèrera aux métamorphoses étonnantes de Chris Hemsworth en James Hunt charismatique et de Daniel Brühl en Niki Lauda méticuleux. Spécialisé dans certaines grosses productions (Thor et The avengers), le premier désirait travailler avec Ron Howard depuis longtemps et accepta immédiatement l’offre. Il se documenta ensuite sur la vie du héros anglais disparu en 1993, rencontra son fils, et ceux – et celles – qui l’avaient côtoyé. Le second vient d’un cinéma plus « cérébral ». Remarqué dans Joyeux Noël, Goodbye Lenin ou Inglorious bastards., il dispose d’un atout clé pour tenir le rôle de Lauda : de nationalité allemande, Brühl parle aussi bien sa langue natale que l’anglais, l’italien où même le français (Lauda parlait allemand avec sa femme, anglais avec ses confrères et italien avec les mécaniciens Ferrari) ! Son défi par rapport à son partenaire australien fut par contre tout autre : il avait la lourde tâche d’incarner à l’écran un homme toujours vivant et mondialement connu. D’abord un peu sceptique, Niki l’invita à venir à Vienne et fut finalement ravi de la rencontre :  « Je lui avais dit au téléphone de prendre un bagage à main, au cas où on ne s’entende pas et qu’il doive faire le retour dans la journée ! Mais bon, ça a collé tout de suite entre nous et il a appris à parler l’anglais avec mon accent autrichien. Il a fait du bon boulot pour être le vrai Niki Lauda ». De même, on est séduit par l’interprétation de Suzy Hunt par la pulpeuse Olivia Wilde, mais surtout charmé par celle, toute en nuances, de Alexandra Maria Lara. Elle est une Marlene Lauda parfaite dans son court bonheur durant sa lune de miel avec cet « ordinateur » qu’elle parvient à décongeler petit à petit – même si cet aspect du caractère de Lauda est trop vite évacué lors d’une courte scène à Ibiza – et dans son soutien douloureux, mais entier, à son mari défiguré qu’elle ne cherchera jamais à éloigner des circuits.
« Je lui avais dit au téléphone de prendre un bagage à main, au cas où on ne s’entende pas et qu’il doive faire le retour dans la journée ! Mais bon, ça a collé tout de suite entre nous et il a appris à parler l’anglais avec mon accent autrichien. Il a fait du bon boulot pour être le vrai Niki Lauda ». De même, on est séduit par l’interprétation de Suzy Hunt par la pulpeuse Olivia Wilde, mais surtout charmé par celle, toute en nuances, de Alexandra Maria Lara. Elle est une Marlene Lauda parfaite dans son court bonheur durant sa lune de miel avec cet « ordinateur » qu’elle parvient à décongeler petit à petit – même si cet aspect du caractère de Lauda est trop vite évacué lors d’une courte scène à Ibiza – et dans son soutien douloureux, mais entier, à son mari défiguré qu’elle ne cherchera jamais à éloigner des circuits.
A ce sujet, la question que tout le monde se pose concerne évidemment l’accident du Nürburgring. Car la dramaturgie de cette saison grimpe de plusieurs degrés après ce 1er août 1976. On pouvait craindre une emphase inutile de la part d’un réalisateur connu pour ses mises en scène efficaces, mais manquant parfois de subtilité. Le moment fatidique arrive (tourné sur les lieux mêmes de l’accident en 1976) et la vision est juste parfaite, sans pathos déplacé : le petit saut sur le vibreur gauche avant Bergwerk, le choc énorme sur le talus à droite, la vue qui se brouille, les voitures qui s’encastrent dans la Ferrari, le feu, Edwards, Ertl et Lunger perdus autour des flammes, la lutte désespérée de Lauda pour dégrafer son harnais, la vision fugitive du casque de Merzario dans le brasier et les quatre hommes qui extirpent le pilote de son enfer. Il n’y a rien à rajouter, Howard filme comme un documentariste ce drame qui se suffit à lui-même – il y a même un plan très furtif en insert d’un spectateur caméra 8mm au poing qui enregistre ces images qui feront le tour du monde. La suite à l’hôpital avec le retour à Monza constitue la partie la plus poignante du film : à la douleur physique des soins intensifs s’ajoute la souffrance morale d’affronter les questions indécentes de certains journalistes plus avides de sensation que d’information pure. La manière dont Hunt va réagir à cette inquisition déplacée donne d’ailleurs lieu à une des scènes les plus fortes du film.

Techniquement, Ron Howard a pu bénéficier du large concours de tous les collectionneurs et propriétaires contactés. Toutes les monoplaces 1976 sont là, des Lotus 77 aux Brabham-Alfa, en passant par la Tyrrell 6 roues, la March 761ou la jolie Ligier JS5. Mais aussi les F3 de 1970, ou l’Hesketh de 1975, car, s’il se concentre en grande partie sur la saison 1975, le scénario aborde en premier la rencontre et la bataille entre les deux pilotes durant la première moitié des années 70. Howard a également eut le loisir de s’installer longuement sur les tracés de Cadwell Park, Donington, Brands Hatch ou Donington pour recréer avec justesse l’ambiance des circuits des mid’ sixties grâce au long travail de Mark Digby (qui avait bossé sur les incroyables décors de Slumdog millionnaire). Les effets numériques ont fait le reste pour reconstituer le Mont Fuji sous le déluge ou bien l’autodrome d’Interlagos dans la furie des sambas. Des pilotes professionnels (dont Jochen Mass) furent engagés pour doubler les acteurs dans les scènes de course et les acteurs ont eux-mêmes piloté des F3 déguisées en F1 pour d’évidentes raisons de sécurité, un peu comme l’avait fait Frankenheimer dans son Grand Prix en 1966. Hormis quelques erreurs inexplicables (le célèbre casque Bell pour Lauda en 1976 à la place de l’AGV – en cause dans l’accident du Ring – ou bien une 312 T de 1975 lors du premier test à Fiorano à l’automne 1973) l’atmosphère générale de l’époque est superbement bien rendue.

Rush est-il la fiction que l’on attendait sur le sport automobile, qui plaira aux fanas comme aux autres ? En bref, qui pourra être considéré comme un véritable film, et non comme un objet catégorisé réservé aux seuls aficionados ? Il sera intéressant à ce sujet d’avoir le point de vue de spectateurs peu versés dans le domaine des « boulons et rondelles ». A quelques réserves près – une mise en scène « coup de poing » un peu trop pesante parfois – c’est en tout cas la bonne surprise de cette rentrée cinématographique.
Pierre Ménard
Rush
Réalisation : Ron Howard
Scénario : Peter Morgan
avec Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Alexandra Maria Lara et Olivia Wilde
123 mn
Sortie nationale : mercredi 25 septembre 2013
Crédits photographiques : © Rush Films Limited